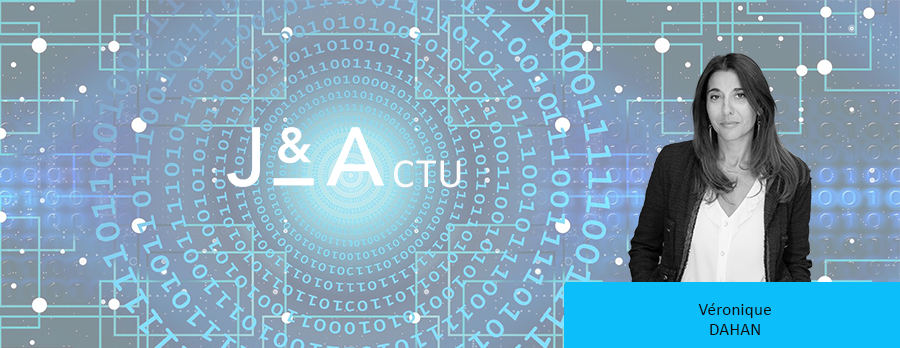Téléchargez ici notre Newsletter
Par Véronique DAHAN
Le 21 avril dernier, la Commission européenne a publié un premier projet de règlement visant à fournir un ensemble de règles harmonisées en matière d’intelligence artificielle (« IA ») au niveau de l’Union, ainsi qu’un plan d’action coordonné avec les Etats membres en la matière.
Depuis plusieurs années, l’Union européenne s’est fixée comme objectif de réguler le numérique à l’échelle des 28 (aujourd’hui 27). Une première étape a déjà été franchie avec le règlement UE 2016/679 dit « Règlement RGPD ». Elle se tourne désormais vers l’IA. Qu’est-ce que l’IA ? L’IA peut désigner l’ensemble des techniques, des procédés utilisés pour tenter de reproduire l’intelligence humaine. Des techniques de prédiction et d’optimisation qui peuvent améliorer la compétitivité des entreprises mais également de l’économie européenne. Toutefois, cela n’est pas sans inconvénients, une telle technologie peut également apporter des risques pour les individus et pour la société. L’Union Européenne en a conscience. Après diverses publications et lignes directrices en 2018 et 2019, un livre blanc de la Commission sur l’IA a été publié en 2020 afin de définir son écosystème au niveau européen. Un an après ce livre blanc, qui a permis de fixer les lignes directrices, la Commission européenne publie de nouvelles règles et un plan d’action visant à promouvoir la confiance dans l’IA. Une confiance qui, pour reprendre les mots de Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, « n’est pas un luxe mais une nécessité absolue ».
Cet ensemble de règles tend à s’assurer, d’une part, que les systèmes d’IA utilisés sur le marché européen soient sûrs et respectent les droits fondamentaux et les valeurs de l’Union européenne. D’autre part, il souhaite assurer une sécurité juridique pour faciliter les investissements et innovations en matière d’IA.
Pour y parvenir, la Commission a, tout d’abord, opté pour un champ d’application extensible. En effet, la Commission aurait la possibilité d’amender, par voie d’actes délégués, l’annexe 1 du règlement afin de se tenir à jour des éventuelles évolutions technologiques en matière d’IA. Ensuite, il a été retenu une approche fondée sur les risques. Cette approche entend classifier les utilisations de systèmes d’IA de la manière suivante : risque inacceptable, risque élevé et risque faible ou minime. Les systèmes d’IA catégorisés comme créant un risque inacceptable seront prohibés, il s’agit notamment des systèmes violant les droits fondamentaux et/ou les valeurs de l’Union. Les systèmes d’IA qualifiés à haut risque sont ceux qui sont susceptibles de causer un risque pour la santé ou la sécurité des individus. Ces systèmes devront se mettre en conformité avec des exigences obligatoires. Pour ce qui est de la dernière catégorie, ceux-ci seront libre d’utilisation ou soumis à certaines exigences de transparence pour ceux qui représentent un risque minime. Enfin, ce projet ouvre la possibilité de mettre en place des codes de conduite. Des codes qui auront pour objet d’encourager les systèmes d’IA ne représentant pas un risque élevé à appliquer volontairement les exigences obligatoires s’imposant aux systèmes à risque élevé.
Ce projet s’inscrit dans un objectif plus global, faire de l’Union européenne un pôle de référence en matière d’intelligence artificielle. Désormais publié, ce projet doit maintenant être adopté par le Parlement européen et les Etats membres dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Ce n’est qu’après cette étape que le règlement deviendra applicable dans l’ensemble des pays de l’Union européenne.